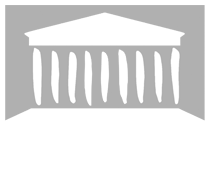FAQ du Citoyen

Retrouvez l'ensemble des questions et des réponses que vous avez souhaitées me poser :
Pourquoi avoir voté en faveur de la réforme des retraites proposée par le Gouvernement ?
J’entends le mécontentement et je peux comprendre que cette réforme puisse inquiéter car elle nous touche tous personnellement. Néanmoins, si je n’ai pas souhaité m’y opposer, c’est en raison de la nécessité pour notre système d’être réformé afin que nous puissions le garder et le transmettre aux futures générations.
Avec le groupe Démocrate, nous avons souhaité améliorer le texte pour accentuer les mesures de justice sociale, avec la prise en compte des périodes de congés maternité dans le calcul de la retraite, la possibilité de partir plus tôt pour les personnes ayant commencé à travailler avant 21 ans et la revalorisation des petites retraites. Ces avancées sont importantes. Toutefois, nous considérons que l’ampleur de cette réforme des retraites nécessite une « clause de revoyure » d’ici l’automne 2027, tant pour dresser le bilan de celle-ci que pour décider d’éventuelles mesures d’adaptation ou de rééquilibrage budgétaire.
Il est nécessaire de poursuivre le dialogue et de co-construire notre société avec les citoyens. C’est pourquoi, nous avons toujours souhaité entretenir les discussions avec les syndicats et notre porte est, encore aujourd’hui, ouverte.
Durant les débats parlementaires, j’ai pu rencontrer à plusieurs reprises les syndicats de mon territoire, pour échanger avec eux et écouter leurs propositions. Je vois aujourd’hui le mécontentement d’une partie de la population, la violence exprimée par certains, qui va bien au-delà d’une contestation contre la réforme des retraites. Il faut que nous puissions travailler conjointement avec les citoyens et c’est pourquoi, je me félicite des initiatives telle que la convention citoyenne. Grâce à cet outil et à la poursuite du dialogue, je pense que nous pouvons continuer à renforcer notre procédure démocratique et éviter ainsi de faire le lit aux extrêmes.
Continuez-vous à travailler contre le harcèlement scolaire ?
Le harcèlement scolaire est un fléau aujourd’hui, qui existait avant et qui continue de perdurer aujourd’hui, sous des formes différentes, notamment en raison des réseaux sociaux. Dorénavant, le harcèlement ne s’arrête plus aux portes de l’école, une fois la journée terminée, il se poursuit en ligne. Il ne s’arrête plus.
Ma motivation pour lutter contre ce fléau est intacte. La loi, que j’ai portée, du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire a un an et nous devons encore patienter pour analyser ses effets car le temps de la justice, n’est pas celui de notre société. Les valeurs telles que l’esprit civique, la politesse, le respect d’autrui, la non-violence, la dialogue sont essentielles et c’est pourquoi, je répète régulièrement dans mes prises de parole, la nécessité d’avoir une école de la bienveillance et du respect, de développer un réel sens de la camaraderie. Pour cela, l’école doit, entre autre, axer sa politique sur la prévention, et cela est dorénavant obligatoire depuis la loi que j’ai portée, car au-delà de l’aspect répressif, il faut instaurer un climat de confiance et agir en amont du fléau.
Pour finir, nous ne pouvons oublier le rôle des parents dans l’éducation de leurs enfants, dans leur capacité à les écouter, qu’il soit victime ou auteur de harcèlement.
Les réseaux sociaux ont changé notre manière d’aborder l’autre et c’est pourquoi, certains de mes collègues, à l’image de Bruno Studer ou Laurent Marcangelli, travaillent pour limiter leurs effets négatifs.
Pourquoi est-il impossible de s’exprimer sur des sujets qui sont notre quotidien et pour lesquels nous pouvons avoir une expertise ?
Donner la parole aux citoyens et leur permettre d'apporter leur expertise et leurs compétences régulièrement est un défi institutionnel. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas dans une démocratie participative, c'est pour une raison organisationnelle et parce que nous avons fait le choix d'un régime politique représentatif.
Néanmoins, il nous faut développer des outils participatifs plus importants car notre démocratie a besoin d'être questionnée et alimentée. Le monde associatif organise déjà beaucoup d'instances de démocratie directe pour créer des lieux et des temps d'échanges avant de faire remonter leurs informations auprès du Gouvernement et des parlementaires. Pour autant, je suis convaincu que les instances républicaines ont besoin de donner une place plus importante à la parole citoyenne.
La création du conseil national de la refondation (CNR) illustre cette volonté de pérenniser la dynamique qui a été lancée par la mise en place du grand débat suite au mouvement social des gilets jaunes. Le CNR réunit des acteurs compétents selon le sujet et des citoyens tirés au sort selon une triple structuration :
- Sous forme plénière, à savoir à l'échelle nationale ;
- Sous forme territoriale, pour une déclinaison des débats à l'échelle locale ;
- Sous forme thématique, pour se concentrer sur un sujet sociétal par débat.
Qu'est-ce que les résolutions votées à l'Assemblée nationale ? Qu'elle portée ont-elles ?
Instaurée par la réforme constitutionnelle de 2008, la résolution parlementaire donne la possibilité aux membres du Parlement de voter un texte pour exprimer leur souhait ou leur préoccupation sur divers sujets. Contrairement à la loi, les résolutions n'ont pas de valeur contraignante. Elles ont pour objectif de permettre aux parlementaires de donner leur avis sur une question de leur choix dans certaines limites. Inscrit à l'article 34-1 de la Constitution, elles font l'objet d'une procédure encadrée :
"Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique. Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard."
Ainsi, le Gouvernement est informé du vote d'une résolution au moins 48h avant afin de vérifier sa recevabilité.
La portée d'une résolution peut paraître symbolique car elle a moins de valeur juridique qu'une loi ou qu'un décret mais leur utilité n'en est pas moindre. Dans l'esprit de la réforme constitutionnelle de 2008, la réhabilitation de cette procédure qui existait déjà sous la IVe République avec une valeur plus contraignante, avait pour objectif de valoriser leur rôle du Parlement. Le vote d'une résolution permet aux députés et aux sénateurs d'exprimer leur point de vue sur un sujet important, notamment européen ou international. Récemment, l'Assemblée nationale a voté une proposition de résolution visant à soutenir le combat des femmes et des hommes en Iran et a appelé le Gouvernement iranien à respecter ses obligations internationales. Cela permet de mettre en lumière des faits et des enjeux d'actualité majeurs. Bernard Acoyer, ancien président de l'Assemblée nationale résumait parfaitement la portée des résolutions : "La résolution, c'est pour expliquer. La loi, c'est pour agir." Ces deux outils sont essentiels pour que notre démocratie fonctionne.
Quel est l'usage des machines à voter aujourd'hui ?
La première utilisation des machines à voter remonte aux élections présidentielles de 2002. Elles ne sont alors utilisées qu'à titre expérimentales dans trois communes. Seul le vote traditionnel était pris en compte pour le résultat de ces élections. L'année suivante, le Ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, fixe les conditions d'agréments permettant d'utiliser ces machines. Cela a permis à la ville de Brest d'être la première à utiliser ces machines en lieu et place des urnes traditionnelles lors des élections cantonales et régionales en mars 2004.
La possibilité pour les communes d'utiliser des machines à voter lors de certaines élections est ouverte par l'article L57-1 du Code électoral. Il dispose qu'elles peuvent être utilisées dans les communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste fixée par arrêté préfectoral dans chaque département. Jusqu'en 2007 une centaine de communes en a fait l'acquisition. Cependant, depuis 2008, les gouvernements successifs ont figé l'acquisition et l'implantation de nouvelles machines. Les raisons qui ont justifié la mise en oeuvre de ce moratoire tiennent à l'allongement des temps d'attente dans les bureaux équipés, au coût pour les communes et l'Etat, évalué entre 4 000 et 6 000 euros en 2007 pour l'achat d'une machine. A ces considérations pratiques et financières s'ajoutent la problématique de confiance de la part des citoyens, notamment liée à l'impossibilité de procéder à un comptage physique des suffrages, ainsi que l'avait relevé le Conseil constitutionnel dans ses observations sur les scrutins présidentiel et législatif de 2007. Enfin, le niveau élevé de risques "cyber" doit désormais être pris en compte dans l'appréhension des opérations de vote réalisées à l'aide de machines à voter. En tout état de cause, les communes propriétaires de ces machines ont toujours le droit de les utiliser lors d'élections.
En vue des dernières élections présidentielle et législative, le Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait diffusé à destination des maires concernés une instruction indiquant les dispositions à mettre en oeuvre pour l'utilisation de ces machines. L'objectif était ainsi d'assurer l'organisation matérielle et le bon déroulement des scrutins dans le respect des dispositions du code électoral. Ces instructions visaient notamment à sécuriser les machines en amont du scrutin (stockage, suivi des machines, configuration des machines), à sécuriser l'organisation du scrutin (information des électeurs en amont du scrutin, mise à disposition des bulletins de vote, information relative au fonctionnement des machines...), à sécuriser le déroulement des opérations de vote et la clôture du scrutin ainsi que les établissements de procès-verbaux.